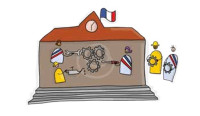Revue
Grand entretienJacques Lévy : «En matière d’urbanisme, il faut écouter les habitants»

Géographe français de renommée internationale, Jacques Lévy vient d’être récompensé par le prix Vautrin-Lud 2018, considéré comme l’équivalent du prix Nobel de géographie. Il a fortement influencé l’évolution de la pensée géographique au cours des dernières décennies et a largement contribué au rapprochement de la géographie et des sciences sociales. Plutôt orientés vers la théorie, ses travaux– extrêmement novateurs – portent sur l’espace politique, la ville et l’urbanité, la mondialisation ou la cartographie. Le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, qu’il a codirigé avec Michel Lussault, constitue un renouvellement majeur du vocabulaire des sciences sociales de l’espace et une mise en cohérence du discours géographique. Nous avons pu le rencontrer à l’occasion de la dernière édition du festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges consacré cette année à la France de demain.