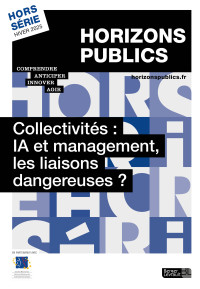Revue
DossierHélène Guillet : «L’IAG est un sujet politique, au sens vie de la cité, et stratégique, au sens de l’action publique»

Hélène Guillet est présidente du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) et directrice générale du Centre de gestion de Loire-Atlantique. Selon elle, le développement de l’IAG dans les organisations va s'accompagner d'une accélération de la réflexion en matière managériale, par exemple, sur les questions des rythmes de travail, de l’allégement des circuits de décision et plus largement de l’autonomie des agents. La priorité est de mettre « les mains dans le cambouis » dès à présent en expérimentant la mise en place de l’IAG dans les collectivités sur des périmètres ciblés, ce qui n’empêche pas de garder de la hauteur de vue.