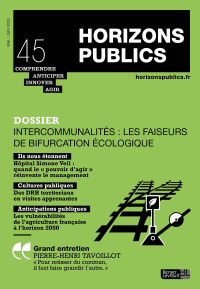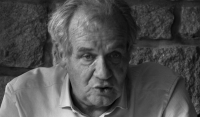Didier Locatelli, directeur du cabinet NewDeal, et Martin Vanier, géographe et cofondateur de la coopérative Acadie, ont accompagné en 2023-2024 l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) dans la conception du film Et si l’écologie était la matrice des politiques intercommunales ? 1. Ils ont alors entrepris un petit tour de France pour projeter ce film en public dans une douzaine de territoires2 et proposer le débat aux élus, aux agents des collectivités, aux partenaires locaux, aux citoyens parfois. Dialogue à partir de ce qu’ils en ont retenu.
Martin Vanier (M. V.) – Avec le recul de quelques mois par rapport à cette douzaine de rendez-vous passionnants, ce que j’en retiens est paradoxal. D’un côté, ce qui m’a frappé c’est à quel point le film saisissait les salles, avec des participants qui retenaient leur souffle au moment où la lumière se rallumait, comme s’ils étaient un peu submergés par l’ampleur des enjeux. Et de l’autre, le fait que, dans le débat ensuite, on a pu mesurer rapidement les divergences entre celles et ceux qui trouvaient qu’on n’avançait pas assez vite dans la « grande bifurcation » et d’autres plus dubitatifs…
Cet article est réservé aux abonnés.
OU
Abonnez-vous à la revue Horizons publics
-
Formule Intégrale Pro
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 10 comptes d'accès au site
-
Formule Intégrale Perso
6 numéros par an
+ 4 hors-séries
+ 1 compte d'accès au site
S'abonner